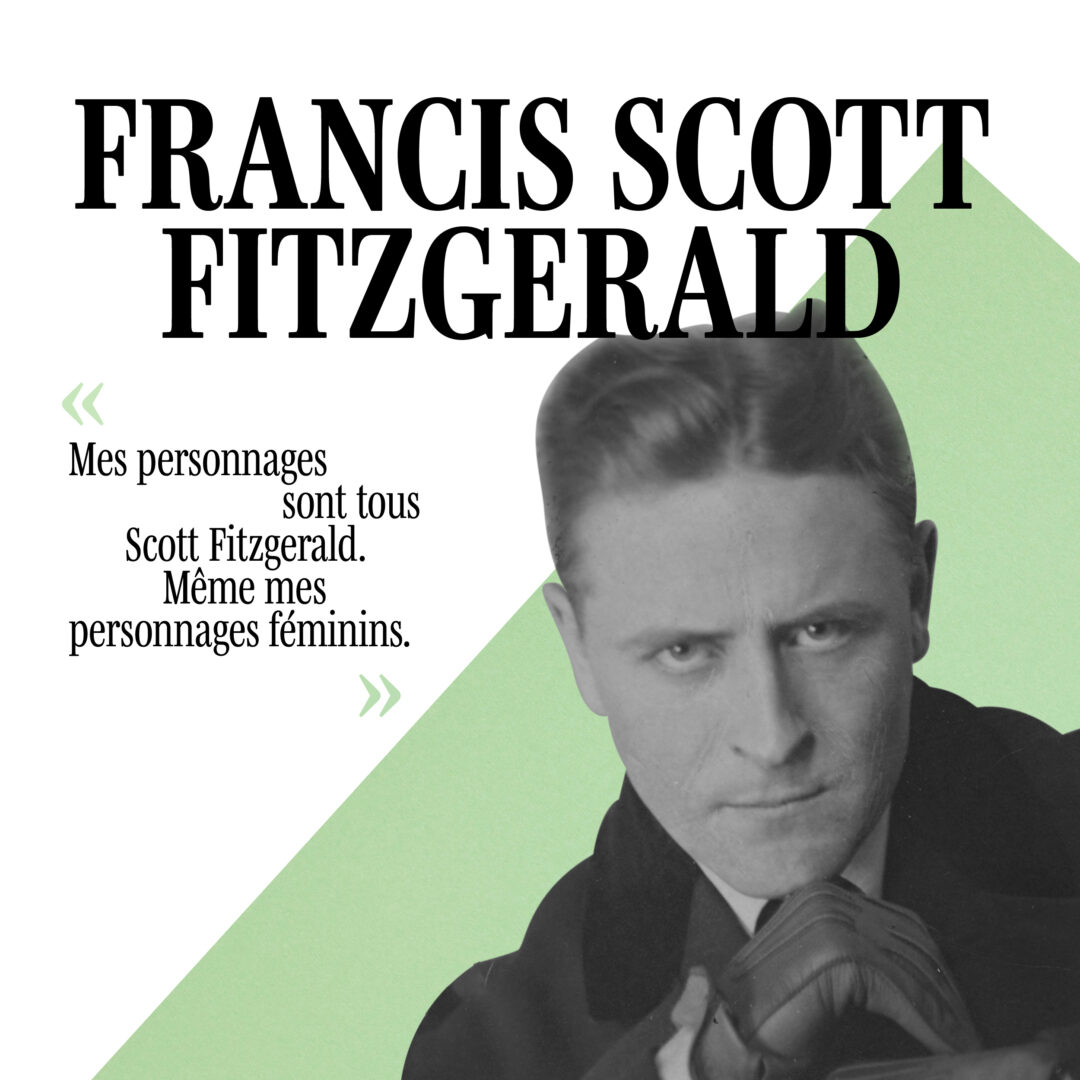
Scott Fitzgerald est mort en décembre 1940. Sa vie fut son plus beau roman : il se grisa de sa jeunesse, de son succès, de son talent. Puis il connut le doute. Ce qui avait été fantaisie éblouissante devint déséquilibre, angoisse et solitude.
Scott Fitzgerald se serait certainement prêté au jeu de l’interview : il était brillant, plein d’esprit et d’invention. Son œuvre et sa correspondance nous permettent d’imaginer ce qu’aurait pu être un tel entretien.
Ce questionnaire est paru dans un dossier d’introduction à Gatsby, publié par la Bibliothèque du Club de la Femme en 1969. Toutes les réponses sont extraites des œuvres de Fitzgerald.
Un écrivain doit-il selon vous, rechercher l’objectivité ou sa propre vérité, c’est-à-dire aller à la découverte de lui-même ?
Avoir quelque chose à dire est une question de nuits sans sommeil, de soucis, de ratiocinations interminables, d’efforts qui ne le sont pas moins, pour extraire la vérité essentielle, l’essentielle justice. La condition préalable est de développer une conscience, et si vous avez de surcroît du talent, tant mieux. Mais si vous avez le talent sans conscience, vous n’êtes qu’un journaliste parmi des milliers et des milliers. Le travail de tout bon écrivain : nager sous l’eau en retenant son souffle.
Écrivez-vous avec facilité ?
Je suis un bûcheur. J’ai dit un jour à Ernest Hemingway, contre toute logique qui avait cours alors, que j’étais la tortue et lui le lièvre, et c’est la vérité : tout ce que j’ai atteint l’a été par une lutte longue et tenace, tandis qu’Ernest a un génie qui lui permet de sortir des choses extraordinaires avec facilité. Je n’ai pas de facilité, je me bats avec chaque virgule. On m’a généralement reconnu, pendant des années, comme le premier écrivain américain, le plus sérieux et le plus commercial à la fois… Je croyais honnêtement que, sans effort de ma part, j’étais une sorte de magicien des mots – curieuse illusion –, alors que j’avais travaillé si désespérément pour me former un style vigoureux, coloré.
Vous avez connu la plus éclatante réussite, puisque vous avez été le plus célèbre écrivain de votre temps. Vous avez aussi dû faire face à de graves échecs. Avez-vous été plus marqué par vos succès ou par vos échecs ?
Ce sont les échecs de la vie, et non ses succès, qui nous en apprennent le plus.
Que vous apporte la vie ?
La vie, en somme, n’a pas grand-chose à offrir, excepté la jeunesse et, je suppose, pour les gens âgés, l’amour de la jeunesse des autres.
Dans l’une des nombreuses lettres que vous avez écrites à votre fille Scottie, vous vous attachez à lui donner le sens des valeurs importantes, avec humour et tendresse. Quels conseils lui donnez-vous ?
Choses dont il faut se soucier :
Se soucier d’être courageux.
Se soucier d’être propre.
Se soucier d’être efficace.
Se soucier d’apprendre à monter à cheval.
Se soucier, etc.
Choses dont il ne faut pas se soucier :
Ne pas se soucier du qu’en dira-t-on.
Ne pas se soucier des poupées.
Ne pas se soucier du passé.
Ne pas se soucier du futur.
Ne pas se soucier de devenir grande.
Ne pas se soucier de ne pas être la première.
Ne pas se soucier de triompher.
Ne pas se soucier d’un échec à moins que tu n’en sois responsable.
Ne pas se soucier des moustiques.
Ne pas se soucier des mouches.
Ne pas se soucier des insectes en général.
Ne pas se soucier des parents.
Ne pas se soucier des garçons.
Ne pas se soucier des déceptions.
Ne pas se soucier des plaisirs.
Ne pas se soucier des satisfactions.
Chose à laquelle il faut penser : quel est exactement mon but ?
Vous appartenez à un pays et à une époque modernes, en pleine évolution, en pleine mutation. Cependant, on ne peut s’empêcher, à votre sujet, de songer aux Romantiques, à Musset…
Je suis un romantique… et il est trop tard pour changer. Je suis mûr – en fait j’étais mûr à trente ans, mais je ne le savais pas. Maintenant, ma croissance est achevée. Je ne peux plus écrire que d’une façon, parce que mes idées ne changeront plus. Mais il y a une nouvelle note qui se glisse dans la littérature, à cause du socialisme. Elle indique une morale et un but. J’appartiens à une période intermédiaire, entre deux périodes moralisantes.
Vos personnages sont-ils tous nés de votre imagination ?
Je suis un introverti intuitif. Je prends les êtres en moi, je change ma conception d’eux et puis je les retranscris. Mes personnages sont tous Scott Fitzgerald. Même mes personnages féminins sont des Scott Fitzgerald.
Êtes-vous sensible à l’intérêt que l’on vous porte ?
J’ai besoin d’être aimé. Je paie cher pour être aimé. J’ai tant de défauts que je dois emporter l’adhésion par d’autres manières.
Peu de gens ont eu autant d’amis que vous. Cependant, la solitude, en vous, demeure ?
Chacun est seul – surtout l’artiste ; cela va de pair avec la création. Je crée un monde pour les autres. À cause de cela les femmes veulent partir avec moi, elles croient que le monde de délices que je fabrique pour elles durera toujours. Je les fais briller, je les rends très importantes à leurs propres yeux.
Un seul grand amour nourrit votre vie, Zelda. Elle fut votre jeunesse, votre joie, puis votre douleur… lorsque son esprit, trop sensible et trop faible pour surmonter ses contradictions profondes, sombra dans l’incohérence… Un tel amour, en dépit des apparences, ne pouvait s’achever ?
Zelda et moi étions tout l’un pour l’autre. Nous formions à nous deux un univers clos. Nous étions frère et sœur, mère et fils, père et fille, mari et femme. Ma vie s’est terminée quand Zelda et moi avons craqué.
Zelda était une artiste parce que vivant toujours très intensément. Son équilibre fut compromis parce qu’elle était trop exigeante, trop orgueilleuse peut-être. Les temps modernes ne semblent pas favoriser l’équilibre des femmes.
Les femmes sont vraiment si faibles – émotionnellement instables et quand les nerfs sont tendus, ils cassent. Elles endurent mieux la douleur physique que les hommes et aussi l’ennui. L’ennui, elles le supportent incroyablement, mais elles ne savent pas se maîtriser, ni maîtriser une tension émotionnelle. Les plus grandes femmes de tous les temps comme Florence Nightingale1, Jane Addams2, Julia Ward Howe3 leur œuvre a été sublime et utile. Elles n’avaient pas de conflit comme Zelda.
Quels sont vos défauts les plus attachants ?
Je suis faible, égoïste, mais j’ai une forte volonté. Je manque de patience, et quand je veux quelque chose, je le veux. Je brise les gens. Je fais partie de la désintégration des temps.
Vous avez abusé de l’alcool. Ce ne fut d’abord qu’un divertissement. Bientôt, ce fut une drogue…
L’alcool est une évasion. C’est pourquoi tant de gens boivent maintenant. L’incertitude du monde où nous vivons, tous les esprits sensibles l’éprouvent. Le vieil ordre se meurt, et nous nous demandons ce qui nous attend dans le nouveau – quelque chose ou rien ?
La vie n’est pas heureuse. Tout ce que je lui demande est d’être tolérable.
Vous avez fréquenté Hollywood. Vous avez travaillé pour de grands metteurs en scène. Que représente pour vous ce monde du cinéma ?
C’est un mélange curieux de quelques hommes remarquables et surmenés qui font des films et d’une foule de faux jetons et de tâcherons à l’arrière-plan, aussi lugubres que vous pouvez l’imaginer.
Votre mère voulait que vous échappiez de la médiocrité matérielle qui était celle de vos parents. Vous avez réussi au-delà de ses espérances. Vous avez été un homme riche et cette richesse, vous ne la deviez qu’à votre talent. L’argent vous a permis de découvrir le monde des riches. Quelle leçon en avez-vous tirée ?
J’ai été un garçon pauvre dans une ville riche ; un garçon pauvre dans une école de garçons riches ; un garçon pauvre dans un club d’étudiants riches à Princeton. Je n’ai jamais pu pardonner aux riches d’être riches, ce qui assombrit toute ma vie et toutes mes œuvres. Tout le sens de Gatsby, c’est l’injustice qui empêche un jeune homme pauvre d’épouser une jeune fille qui a de l’argent. Ce thème revient sans cesse parce que je l’ai vécu.
Une ambition particulière a-t-elle guidé toute votre vie ?
Rester marié avec Zelda, amoureux d’elle, et écrire le plus grand roman du monde.
En 1926, vous revenez en Amérique, après un séjour en Europe. Comment vous apparaît alors la vie américaine de l’époque ?
L’agitation… confinait à l’hystérie. Les réceptions étaient plus riches, les étalages plus vastes, les bâtiments plus hauts, la moralité plus basse, et l’alcool meilleur marché : mais tous ces bienfaits ne donnaient guère de plaisir. Les jeunes gens s’usaient tôt – ils étaient durcis et las à vingt et un ans, la plupart de mes amis buvaient trop – plus ils étaient en harmonie avec l’époque, plus ils buvaient… La ville était bouffie, gorgée, stupide de gâteaux et de cirques, et une nouvelle expression, oh yeah ? résumait tout l’enthousiasme suscité par l’annonce des derniers super-gratte-ciels.
Mais vous devez avouer que vous avez été en quelque sorte fasciné par la richesse ?
La richesse ne m’a jamais séduit, à moins d’être associée au charme le plus exquis et à une grande distinction.
Vous avez beaucoup voyagé, vous connaissez bien toute l’Europe. Quelle place la France et la culture française tiennent-elles dans votre esprit ?
La France m’a d’abord écœuré par sa prétention à être l’objet sans prix que le monde a le devoir de sauver (cette déclaration est datée de mai 1921).
Cependant, plus tard, je me suis mis à aimer la France.
En fait de littérature, Anatole France mort, la littérature française ne sera plus qu’un envieux et stupide rabâchage de querelles de techniciens… Dans vingt-cinq ans, New York sera la capitale de la culture, elle sera exactement ce qu’est Londres de nos jours. La culture suit l’argent et tous les raffinements des esthètes n’empêcheront pas que son siège ne se déplace.
Certaines lectures vous ont-elles marqué ?
Le Nègre du « Narcisse » de Conrad : ce livre est demeuré pour moi le credo le plus sacré de ma vie depuis que j’ai résolu d’être écrivain plutôt qu’auteur à succès. Je préférerais laisser mon empreinte (fut-elle minuscule) sur l’âme d’un peuple plutôt qu’être célèbre, sous réserve de pouvoir remplir mes obligations familiales et suffire à nos besoins. Si j’étais sûr d’atteindre ce but, j’aimerais mieux demeurer aussi longtemps ignoré que Rimbaud. Il n’y a là de ma part aucune sotte prétention au désintéressement : c’est tout bonnement parce qu’ayant eu jadis la révélation de la puissance de l’art, j’estime que rien d’autre dans la vie ne saurait m’arriver qui puisse me paraître aussi important que l’activité créatrice.
En 1935, votre santé devient un tourment quotidien (les excès d’alcool éprouvent votre résistance nerveuse) et votre activité créatrice en souffre profondément…
À partir de 1933, le physique n’a cessé de décliner par degrés vers l’anéantissement, mais la chute ne s’est accentuée que vers l’automne 1934, et elle a alors été rapide. Je ne pouvais plus écrire sans gin, sans cigarette et sans bromure, et je vivais d’espoir. Finalement, ce que j’écrivais devenait tellement pauvre que j’ai résolu de me tirer de ce marasme pendant que je tenais encore debout. Je me suis fait soigner à Tryon en Caroline du Nord, me suis vite rétabli, j’ai décidé de cesser de boire pendant quelques années (ce qui, à vrai dire, ne m’a pas coûté jusqu’à présent) et me voici tout à fait remis. (En hiver et au printemps de 1935, Fitzgerald fit, en effet, un effort pour guérir, mais il n’y réussit qu’en 1937).
Vous avez été un grand admirateur d’Ernest Hemingway. Ébloui par sa force, son charme, son talent, vous n’avez cessé d’affirmer la supériorité de cet écrivain américain dont le grand thème est le courage. Dès 1924, vous pressentiez son avenir et écriviez : « Je vous envoie ce mot pour vous parler d’un jeune Américain nommé Ernest Hemingway. C’est certainement quelqu’un. C’est un garçon d’avenir et il n’a que vingt-sept ans. » Quelle différence faites-vous entre votre talent et celui d’Ernest Hemingway ?
Un jour où je m’entretenais avec Hemingway, je lui ai dit que, contrairement à ce qui paraissait vraisemblable, j’étais la tortue et lui le lièvre, et c’était vrai : tout ce que j’ai réussi est le fruit d’un effort têtu et prolongé tandis que c’est Ernest qui, avec une pointe de génie, parvient à produire facilement des choses extraordinaires. Je manque de facilité.
Selon vous, en quoi un artiste se distingue-t-il d’un homme sensible ?
Pour faire un artiste, il faut l’égotisme d’un fou joint à la clarté et à la vigueur de pensée d’un Flaubert. La quantité de talent nécessaire au départ – ou disons le degré d’habileté et de facilité – n’entre que pour une très faible proportion dans la longue lutte de l’artiste, un combat dont la fin la plus heureuse ne peut être qu’un prompt et miséricordieux épuisement.
Dossier d’introduction à Gatsby, Bibliothèque du Club de la Femme, 1969.
1. Florence Nightingale (1820-1910) : pionnière des soins infirmiers modernes et de l’utilisation des statistiques dans le domaine de la santé publique, elle fut, à la fin du xixe siècle, la femme britannique la plus célèbre après la Reine Victoria.
2. Jane Addams (1860-1935) : activiste américaine, réformatrice sociale, écrivain, elle milita pour le droit de vote des femmes et la paix dans le monde. Elle obtint le Prix Nobel en 1931.
3. Julia Ward Howe (1819-1910) : militante abolitionniste et poétesse américaine. Elle défendit, comme Jane Addams, le droit de vote des femmes et le pacifisme. Auteur du texte The Battle Hymn of the Republic, l’un des chants les plus populaires durant la guerre de Sécession, elle fut, en 1908, la première femme élue à l’Académie américaine des Arts et Lettres.