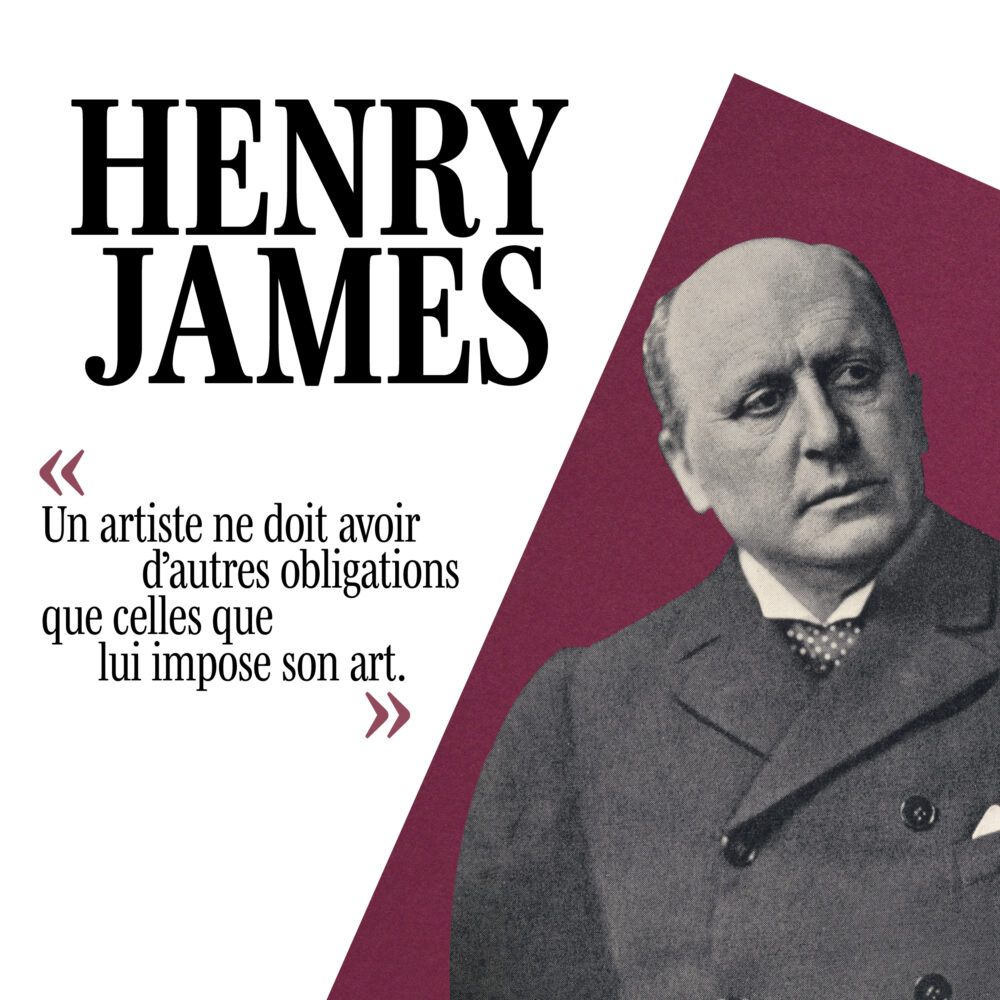
Se référant aux Carnets de Henry James, un dialogue a pu être reconstitué entre un journaliste imaginaire et l’auteur de Washington Square. Il ouvre une édition de ce célèbre roman publiée en 1964 par le Cercle du bibliophile. Cet « entretien » nous met en présence de la pensée et de la sensibilité de James, homme du Nouveau Monde, amoureux de la vieille civilisation européenne.
Monsieur Henry James, vous êtes né à New York, en 1843. Vous avez cependant passé la plus grande partie de votre enfance en Europe. Au contact de l’Angleterre, de la France, de la Suisse, vous vous êtes, très, très jeune, familiarisé avec la culture européenne. Et cette vieille Europe a envahi votre cœur au point que vous vous êtes toujours senti bien plus européen qu’américain. Sans doute, aimez-vous beaucoup votre pays natal ; vous lui reconnaissez des qualités de jeunesse et de naturel, mais c’est pour vous un pays trop neuf…
Notre rude climat, notre passé silencieux, notre présent tapageur, la banalité qui nous comprime de tous côtés sont vides de ce qui peut inspirer un artiste… Il faut une telle accumulation d’histoire et de coutumes, une telle complexité de mœurs et de types, pour offrir au romancier un fond d’inspiration… Oui, mon choix c’est le vieux monde, mon choix, mon besoin, ma vie. Inutile d’épiloguer là-dessus ; c’est pour moi un inestimable bienfait et une rare bonne fortune d’avoir réglé ce problème il y a longtemps… Je n’ai que faire du Nouveau Monde.
Comment voyez-vous vos compatriotes ?
L’Américain est un homme pratique, expérimentaliste né, franc, aussi simple qu’un petit enfant, ayant très bonne opinion de lui-même, touriste type… Il croit que tout est fait pour lui.
Et la jeune fille américaine dont vous avez, si souvent, fait l’héroïne de vos romans ?
Riche, charmante, sans vice, flirteuse, mais très innocente ; elle n’a pas l’intention de mal faire. Elle fait tout ce qui n’ose se faire en Europe. Elle se soucie peu de causer du scandale.
En 1875 – vous avez alors 32 ans – vous séjournez à Paris et rencontrez Tourgueniev, Zola, Edmond de Goncourt, Taine, Daudet, Maupassant. C’est aux « Dimanches » de Flaubert que vous faites la connaissance de tous ces représentants de la jeune littérature ?
Oui… En effet… Je ne parlerai pas d’Ivan Tourgueniev, le plus délicieux et aimable des hommes, ni de Gustave Flaubert, que je serai toujours heureux d’avoir connu : nature puissante, grave, mélancolique, virile, profondément corrompue, mais non corruptrice. Quelque chose en lui me plut beaucoup et il se montra fort bienveillant envers moi. Il dominait de la tête et des épaules les autres, tous ceux que je rencontrais chez lui, le dimanche après-midi : Zola, Goncourt, Daudet (je veux dire en tant qu’homme, non comme causeur).
Vous avez adoré Paris ; cependant, la ville où vous vous êtes senti le plus à l’aise est Londres. Vous avez voyagé à travers le monde entier mais Londres fut votre refuge, votre seconde patrie ?
Je m’y suis, en effet, profondément attaché… J’arrivai à Londres en parfait étranger et aujourd’hui, je n’y connais que trop de monde. J’y suis absolument comme chez moi… De Londres, il est difficile de parler de façon pertinente ou juste. Ce n’est pas un lieu plaisant ; il n’est pas agréable, ni gai, ni facile, ni à l’abri de tout reproche. Il n’est que magnifique. On pourrait dresser une importante liste des raisons qui devraient le rendre insupportable. Brouillard, fumée, crasse, obscurité, humidité, distances, laideur, dimensions formidables, horrible pléthore de la société. On peut qualifier Londres de sinistre, lourd, stupide, morne, inhumain, vulgaire au fond du cœur et fatigant par sa forme. J’ai parfois ressenti ces choses avec tant de force que j’ai dit : « Ah, Londres, alors, toi aussi, tu es impossible ? » Mais ce sont là des mouvements d’humeur passagers… Londres, c’est la plus vaste agglomération d’existences, la plus complète synthèse du monde. La race humaine y est mieux représentée que partout ailleurs et si vous apprenez à connaître votre Londres, vous avez beaucoup appris. C’est donc l’endroit rêvé pour un artiste tel que moi qui ai la passion d’observer…
Vous avez toujours détesté les mondanités. Et cela ne devait pas être facile car vous avez été, à Londres, à Paris, à New York, un écrivain « à la mode ».
Le silence, l’isolement, le mystère même sont indispensables si l’on veut créer une œuvre digne de vivre… Le romancier « à la mode » est assailli, harcelé, tracassé. On le déchire en morceaux sous prétexte de l’applaudir.
Vous vous méfiez du succès, et de tout ce qui l’accompagne inévitablement : l’argent, le monde. Ne croyez-vous pas qu’un artiste ait des obligations à l’égard de cette société qui fait son succès ?
Un artiste ne doit avoir d’autres obligations que celles que lui impose son art. Accomplir son œuvre, entièrement, l’accomplir et la rendre divine est la seule chose à laquelle l’artiste devrait penser.
Quelle est l’œuvre, parmi toutes celles que vous avez écrites, que vous préférez ?
La perle ?… Ce qui n’est pas écrit… Ce qui est perdu.
Pourquoi ? Tout ce que vous avez écrit vous laisse à ce point insatisfait ?
On travaille dans les ténèbres ; on fait ce que l’on peut ; on donne ce que l’on a.
Pourriez-vous nous donner une définition du talent ?
Qu’est-ce que le talent sinon l’art d’être complètement ce que le hasard a voulu qu’on soit…
Vous n’êtes pas misanthrope et cependant l’égoïsme des hommes, leur tendance fâcheuse à juger plutôt qu’à comprendre, vous choquent. La vertu suprême, selon vous, consiste à observer la plus grande tolérance possible, n’est-ce pas ?
Tous nous vivons ensemble, et ceux parmi nous qui aiment et qui comprennent, vivent le plus. Nous nous aidons : chacun dans notre propre effort, nous allégeons, même inconsciemment, l’effort des autres ; nous contribuons à la totalité du succès ; nous laissons aux autres la possibilité de vivre.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune débutant ?
Je lui dirais… Laissez votre âme vivre, c’est la seule vie qui ne soit pas, à tout prendre, une déception. Ce qui importe c’est d’être saturé de quelque chose, c’est-à-dire d’une façon ou d’une autre, de la vie. Je ne sais pas pourquoi nous vivons, le don de la vie nous vient je ne sais de quelle source, ni pour quel but. Mais je crois… que la vie est la chose la plus précieuse que nous puissions concevoir, et que c’est une grande faute que de vouloir y renoncer quand il en reste encore dans la coupe. En d’autres termes, la conscience est une puissance illimitée. Même si ce n’est parfois qu’une conscience de la misère, il y a toujours en elle, de la façon dont elle se propage d’onde en onde et ne nous permet jamais de ne plus sentir, quelque chose qui nous retient à notre place, qui devient un point de repère dans l’univers et qu’il serait sûrement bon de ne pas abandonner.
Pensez-vous que la littérature de notre époque (disons celle de 1890) subisse une crise ?
Je pense parfois que la littérature est maintenant morte ou mourante, mourante de vulgarité et d’épuisement, mais quelques talents font renaître ma confiance et m’aident à trouver un but dans la vie.
Éprouvez-vous de l’angoisse à la pensée de la mort ?
Pourquoi faisons-nous tant de bruit au sujet de la mort ? Qu’est-elle, après tout, sinon une forme de raffinement de la vie ?
Toutes les histoires que vous avez écrites ont-elles surgi de votre imagination ou sont-elles nées de la réalité ?
La plupart des histoires auxquelles je me suis efforcé de donner une forme sont issues d’une unique petite graine de la précieuse particule réduite à sa seule essence féconde… La goutte de vérité, de beauté, de réalité à peine visible à l’œil du vulgaire… L’artiste trouve, dans sa minuscule pépite, lavée de ses alluvions gênantes, et martelée jusqu’à la dureté sacrée, la matière même d’une affirmation nette, la plus heureuse chance de réaliser l’indestructible.
Ainsi, pour vous, l’artiste est celui qui perçoit cette part du réel qui échappe à la réalité de la plupart d’entre nous ?
Oui… La faculté de deviner le non-vu d’après le vu ; d’extraire les possibilités impliquées dans les choses, de juger du tout d’après le trait essentiel, de sentir toute la vie si exactement qu’on puisse facilement s’orienter dans tout recoin particulier de la vie – tels sont les dons qui, pourrait-on dire, constituent l’expérience de l’artiste.
Vos carnets forment un très copieux volume. Vous y avez noté tout ce qui, un jour ou l’autre, pourrait vous donner matière à une nouvelle, un roman ou une pièce de théâtre. Il semble que, pour vous, il n’y ait pas de petite anecdote. Tout ce que l’on peut vous raconter au cours d’un dîner, toutes les petites histoires de famille des uns et des autres, vous notez tout soigneusement, comme on engrange du grain…
C’est la loi terrible de l’artiste, la loi de la fructification, de fécondation, et qui fait que tout est mouture pour son moulin. La loi d’acceptation de toute expérience, de toute souffrance, de toute vie, de toutes suggestions, sensations, illuminations…
Écrire est-il, pour vous, un plaisir ou une nécessité ?
C’est mon salut… L’oisiveté prolongée m’exaspère et me déprime.
Travaillez-vous régulièrement et avec discipline ?
J’ai des heures d’inexprimable sursaut contre… mes détestables habitudes de travail – ou de non-travail – ma légèreté, le vague de mon esprit, ma perpétuelle impuissance à fixer sur un point mon attention, à m’observer, à regarder les choses en face, inventer, bref à produire… Une fois vraiment à l’œuvre, je me sens heureux, je me sens fort, j’entrevois devant moi de multiples occasions. Seul, le travail rend la vie supportable. Je devrai néanmoins faire de grands efforts durant ces prochaines années, sous peine d’être un raté total. Un raté, je le serai, à moins d’accomplir quelque chose de Grand !
On dit que vous êtes puritain. Ainsi, l’amour, qui est cependant partout dans votre œuvre, ne se manifeste-t-il que très rarement sous la forme d’une passion physique…
Si l’on observe trop le côté charnel de l’homme, il apparaît comme le plus caractéristique et alors on l’observe trop parce qu’on ne regarde pas les autres. Je crois que l’étalage de « l’Amour » souffre toujours d’une certaine platitude, inévitable et insurmontable…
Êtes-vous sujet aux dépressions ?
Les découragements et les défaillances, les dépressions et les ténèbres ne me viennent qu’autant que je suis hors du lumineux paradis de l’art. Dès que j’y rentre vraiment, que je franchis le seuil aimé, que je suis dans la salle d’honneur et les jardins célestes, tout le royaume se déploie de nouveau devant moi et autour de moi – l’air de la vie dilate mes poumons – la lumière de l’accomplissement colore tout et je crois, je vois, j’agis.
Vous êtes un romancier essentiellement psychologue. Avez-vous le sentiment de bien connaître et de bien comprendre les hommes ?
On ne sait jamais le dernier mot quand il s’agit du cœur humain…
Vous avez toujours été tenté par le théâtre mais vos tentatives ne furent pas réellement couronnées de succès… Le milieu du théâtre, le genre de pièces que l’on vous demandait, vous laissèrent quelque amertume, n’est-ce pas ?
J’ai appris avec acuité que dès l’instant où l’on essaie d’écrire pour le théâtre, il faut se cuirasser contre le dégoût, un dégoût profond, indicible. Pourtant, bien qu’écœuré, je ne me crois nullement découragé… La forme dramatique me paraît le comble de la beauté. Le malheur est que la bassesse du niveau de la scène de langue anglaise ne lui offre pas le cadre voulu.
Le plus grand chagrin que vous ayez ressenti fut, sans doute, ce grand déchirement éprouvé à la mort de votre mère ?
Je savais que je la chérissais, mais j’ignorais combien tendrement je l’aimais, jusqu’à ce que je l’aie vue couchée sous son linceul, dans cette froide chambre exposée au nord ; une tempête de neige, lugubre, faisait rage au-dehors. Elle paraissait aussi douce, calme et digne que de son vivant. Ce sont des heures atrocement douloureuses… Je ne puis m’empêcher de sentir qu’au cours de ces dernières semaines je n’ai pas été assez tendre avec elle, que j’étais aveugle à sa douceur et à sa bonté bienfaisante… À mon retour d’Europe, j’ai été saisi de la trouver si consumée, si décharnée, et maintenant je sais qu’elle était très lasse. Elle continuait à exercer ses activités habituelles mais le fardeau de la vie lui pesait lourdement. Elle aurait eu besoin de repos. Ce fut une parfaite existence de mère – la vie d’une épouse parfaite. Mettre ses enfants au monde, se dépenser pendant des années pour leur bonheur et leur prospérité, puis quand ils eurent atteint la maturité et furent absorbés par le monde et leurs propres intérêts, étendre ses membres las et remettre son âme pure à la puissance céleste qui lui avait donné cette charge divine. Grâce à Dieu, on ne subit pas deux fois une perte semblable, grâce à Dieu, certaines impressions suprêmes demeurent à jamais !
L’homme est sur terre pour être libre, pensez-vous, et pour trouver la forme d’expression qui lui convient le mieux. Mais cette liberté et cette recherche se payent parfois très cher ?
Il y a de la beauté à être déshérité et indépendant, à conquérir le monde d’un élan libre, courageux et personnel… Être c’est se faire, et si faire est un devoir, être est un devoir… Sentir cela, le comprendre et l’accepter, l’adopter et l’embrasser, c’est cela une conduite, c’est cela la vie. Nous devrions reconnaître notre forme particulière, l’instrument que chacun de nous porte dans son être. Maîtriser cet instrument, apprendre à en jouer à la perfection, c’est bien ce que j’appelle devoir, ce que j’appelle conduite, succès.
Vous attendiez beaucoup de la vie, Monsieur James. Vous a-t-elle apporté tout ce que vous espériez ?
Jamais jeune homme ingénu n’attendit avec une ardeur plus passionnée et à la fois plus patiente, ce que la vie tenait en réserve pour lui. Maintenant qu’elle m’a apporté quelque chose, qu’elle m’a donné une appréciable part de ce que je rêvais alors, il est assez émouvant de jeter un coup d’œil en arrière. Du moins, savais-je ce que je voulais : voir un peu le monde. Je l’ai beaucoup vu et je regarde le passé à la lueur de cette connaissance, étonné par la netteté, l’infaillibilité de mes aspirations. Ce que je me proposais de faire, en grande partie, je l’ai fait, et la réussite, si j’ose dire, tend à présent tendrement la main à son jeune frère, le désir. Je me rappelle les jours, les heures, les saisons, les ciels d’hiver et les chambres obscurcies d’été. Je me rappelle les anciennes promenades, les anciens efforts, les anciennes exaltations ou dépressions. Je me rappelle plus que je n’en saurais dire ici aujourd’hui.
Quel est, pour vous, le plus beau mot de toutes les langues ?
Jeunesse.